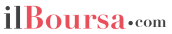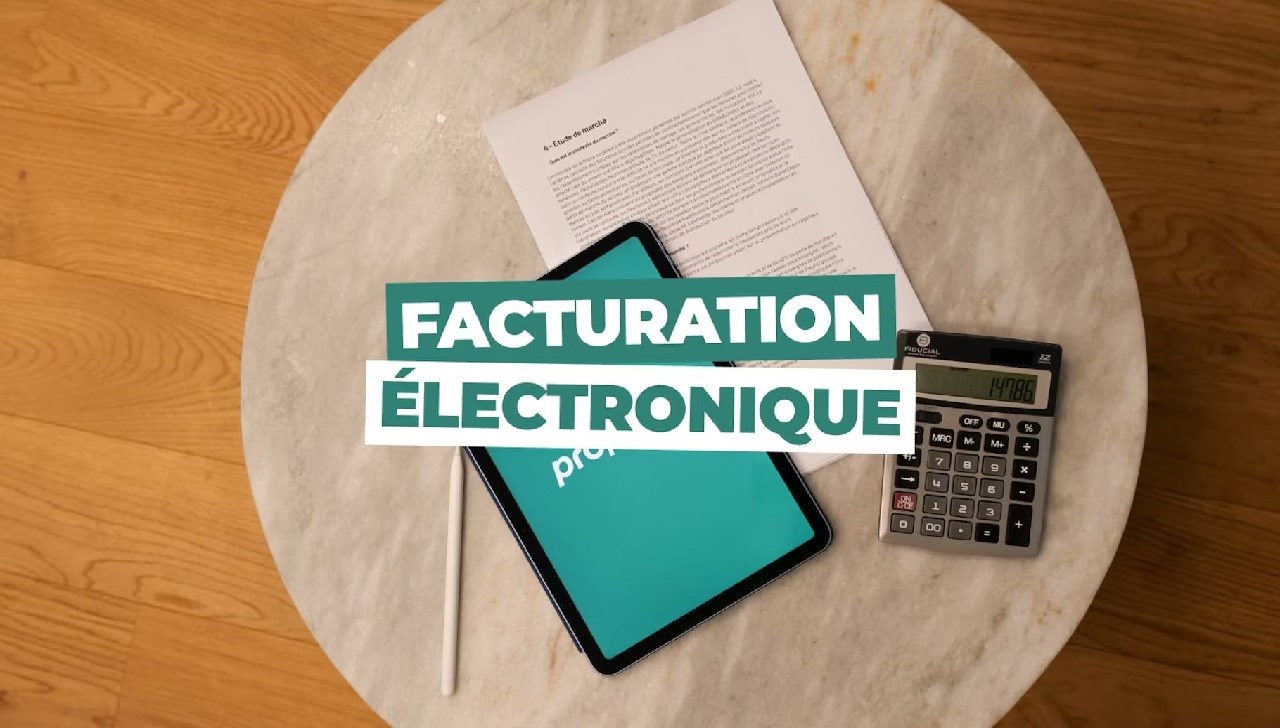
Par Maître Ali Khribi
Conseiller Fiscal Agréé par l'Etat
Membre de la CNCFT
Depuis quelque temps déjà, la Tunisie s'est résolument engagée sur le chemin de la modernisation de son administration fiscale, amorçant un véritable tournant vers l'ère numérique et la fiscalité 2.0.
Ce processus de transformation, bien plus qu'un simple ajustement technique ou organisationnel, incarne une volonté stratégique affirmée de repenser en profondeur les mécanismes de gestion, de contrôle et de transparence dans la relation entre l'État, les contribuables et les opérateurs économiques.
Si les premières impulsions de cette réforme visaient à simplifier les démarches, fluidifier les procédures et limiter les lourdeurs bureaucratiques, le projet a rapidement pris une ampleur bien plus vaste. Aujourd'hui, il s'inscrit au cœur d'une dynamique nationale de lutte contre l'économie souterraine, de réduction des comportements frauduleux et d'amélioration de la performance publique.
La digitalisation fiscale n'est plus une perspective lointaine ou une ambition encore floue. Elle est devenue une composante essentielle de l'architecture administrative tunisienne, se déployant progressivement à travers des initiatives concrètes, des outils performants et des cadres réglementaires adaptés. Parmi ces dernières avancées, la mise en œuvre de la Plateforme de Transfert et d'Échange des Données Fiscales (plus connue sous l'acronyme TEJ) constitue une pierre angulaire de cette mutation.
Cette infrastructure technologique, pensée comme un système nerveux de la gouvernance fiscale, assure aujourd'hui l'interconnexion fluide, sécurisée et automatisée des données entre les acteurs économiques, les institutions publiques et l'administration fiscale elle-même. Elle symbolise à la fois un levier d'efficacité, un vecteur de confiance, et un garde-fou contre l'opacité.
Dans le prolongement naturel de cette modernisation, la facturation électronique s'impose désormais comme le nouveau pilier de la stratégie fiscale nationale à partir du 1er juillet 2025. Mais loin de se réduire à une évolution technologique, elle redéfinit les contours mêmes du fonctionnement fiscal : elle introduit un nouveau régime juridique, transforme les pratiques comptables et bouleverse les habitudes des entreprises comme de l'administration. Elle devient, en somme, un outil central de pilotage, de traçabilité et de conformité, placé au service d'une fiscalité plus juste, plus intelligente et plus résiliente.
Une colonne vertébrale juridique au service de la vision stratégique
La facture électronique en Tunisie repose sur un cadre juridique clair et progressif, dont les fondations remontent à la loi de finances pour l'année 2016. En effet, l'article 22 de ladite loi a introduit pour la première fois la notion de facture électronique, en lui conférant la même valeur légale et fiscale qu'une facture traditionnelle sur support papier.
Le décret n°2016-1066 du 15 août 2016, pris en application de cette loi, a défini les conditions d'émission, d'authentification, de conservation et d'archivage des factures électroniques. Ce décret établit également que la gestion du système est confiée à Tunisia TradeNet (TTN), organisme national chargé de superviser le traitement, la transmission et l'archivage des factures électroniques via sa plateforme sécurisée.
Le cadre réglementaire a été renforcé en 2025, avec l'introduction de l'article 71 de la loi de finances pour l'année 2025, qui marque un tournant important : il instaure des sanctions fiscales et pénales à l'encontre des entreprises qui ne se conforment pas à leurs obligations en matière de facturation électronique à compter du 1er juillet 2025.
Les règles du jeu : qui est concerné et que doit-il faire ?
La mise en œuvre du système de facturation électronique repose sur une approche différenciée selon la nature des opérateurs :
Obligations obligatoires s'appliquent à :
- Les entreprises contractant avec l'État, les collectivités locales et les établissements publics ;
- Les grandes entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) ;
- Les opérations de vente de médicaments et d'hydrocarbures entre professionnels (hors circuits de détail).
L'adhésion est facultative, à titre transitoire, pour :
- Les autres catégories d'entreprises non encore assujetties à l'obligation.
Conditions techniques pour les émetteurs :
- Être titulaire d'un certificat électronique qualifié, délivré par l'Agence Nationale de Certification Électronique (ANCE) ;
- Être abonné au service “El Fatoora” proposé par TTN ;
- Utiliser une solution logicielle compatible avec le TEIF (Tunisian Electronic Invoice Format), format standardisé de facture électronique reconnu par l'administration.
Quelles sont les mentions indispensables pour garantir la validité fiscale d'une facture électronique ?
Pour être fiscalement recevable, la facture électronique doit satisfaire à un ensemble rigoureux de conditions légales et techniques, notamment :
- Inclure toutes les mentions prévues à l'article 18 du Code de la TVA, telles que l'identité des parties, la nature des biens ou services, les montants HT et TTC, le taux de TVA applicable, etc. ;
- Comporter une référence unique attribuée automatiquement par TTN lors de la soumission ;
- Être signée électroniquement par l'émetteur à l'aide de son certificat qualifié ;
- Intégrer un Cachet Électronique Visible (CEV), représenté par un QR code sécurisé, garantissant l'authenticité et l'intégrité de la facture ;
- Être validée par une signature électronique apposée par TTN.
Les factures électroniques peuvent être converties en format PDF lisible pour le client final, sans que cela n'altère leur valeur fiscale. Leur archivage électronique doit répondre aux normes techniques officielles, telles que définies dans un cahier des charges approuvé par TTN.
Quels risques encourt-on dès l'entrée en vigueur des nouvelles sanctions ?
Le dispositif légal devient pleinement contraignant à partir du 1er juillet 2025, avec l'entrée en vigueur d'un régime de sanctions dissuasives :
- Émission de factures papier : Amende de 100 à 500 dinars par facture émise au format papier pour des opérations devant obligatoirement être facturées électroniquement, avec un plafond de 50 000 dinars par contrôle fiscal.
- Transport de marchandises sans justificatif : Amende équivalente à 20 % de la valeur des marchandises transportées sans copie papier de la facture électronique ou document équivalent, avec un minimum de 500 dinars.
- Factures électroniques non conformes : Amende de 250 à 10 000 dinars pour chaque facture électronique ne respectant pas les mentions obligatoires, telles que l'identification du vendeur et de l'acheteur, la description des biens ou services, le montant hors taxe, le taux et le montant de la TVA, ainsi que la signature électronique.
Les entreprises concernées incluent notamment les grandes entreprises, les fournisseurs de l'État, les vendeurs de médicaments et les distributeurs de carburants, à l'exception des détaillants.
Les entreprises concernées disposent d'un délai légal courant jusqu'au 30 juin 2025 pour se mettre en conformité. Passé ce délai, les contrôles fiscaux intègrent systématiquement la vérification des factures électroniques comme critère de régularité.
Et si des solutions intégrées étaient la clé d'une transition réussie ?
Pour accompagner les entreprises dans cette transition, des prestataires technologiques comme NGSign proposent des solutions certifiées qui permettent de :
- Générer automatiquement des factures électroniques conformes au format TEIF ;
- Signer électroniquement les documents à l'aide d'une technologie sécurisée (standard XAdES) ;
- Intégrer les solutions directement avec le système " El Fatoora " de TTN via une API universelle ;
- Produire des copies PDF lisibles pour les clients finaux tout en maintenant la traçabilité légale.
L'objectif est de permettre une intégration fluide avec les systèmes de gestion existants, sans rupture dans les processus comptables ou commerciaux.
Quels sont les coûts réels des services associés ?
TTN applique une tarification progressive pour le traitement et l'archivage des factures électroniques. Le coût de base est de 0,190 dinars HTVA par unité de 50 Ko, avec des tarifs dégressifs pour les volumes importants.
Des options complémentaires sont proposées pour la génération de copies en formats PDF ou XML, facturées selon une grille spécifique.
Une avancée saluée, mais des défis à anticiper
La mise en place de la facturation électronique en Tunisie constitue une étape stratégique dans la modernisation de l'administration fiscale. Elle vise à renforcer la transparence, améliorer le suivi des transactions commerciales et lutter contre l'évasion fiscale, dans une logique de transformation numérique en phase avec les standards internationaux.
Sur le plan réglementaire et technique, le dispositif tunisien présente des fondations solides. Le cadre juridique est structuré, et des prestataires comme NGSign jouent un rôle d'intermédiation essentiel pour faciliter la transition des entreprises vers ce nouveau système. L'adoption progressive de l'obligation témoigne également d'une volonté d'accompagner le changement sans brusquer les acteurs économiques.
Cependant, cette réforme ambitieuse doit être examinée à la lumière de la réalité socio-économique et technologique du pays. En effet, un certain nombre de défis demeurent, notamment pour les PME, TPE, indépendants et professions libérales, qui n'ont pas toujours les moyens humains, techniques ou financiers pour intégrer les outils numériques dans les délais impartis.
Un accompagnement renforcé (sous forme de formations sectorielles gratuites, d'aides financières ciblées, ou encore de dispositifs de soutien technique publics) s'avère indispensable pour garantir une transition inclusive et équitable.
Le succès de la facturation électronique repose également sur la qualité de l'infrastructure numérique nationale. En Tunisie, bien que des avancées aient été réalisées en matière de connectivité Internet, digitalisation des services publics et usage des TIC, des disparités importantes subsistent entre les zones urbaines et rurales.
L'accès à une connexion fiable, à des équipements adaptés et à des compétences numériques de base reste disparate, ce qui peut freiner l'adoption généralisée du système de e-facturation.
Par ailleurs, l'obligation de recourir à un certificat électronique qualifié, de s'inscrire sur une plateforme dédiée et de respecter un format normé (TEIF) pose un défi supplémentaire aux structures peu familiarisées avec l'environnement numérique. Il conviendrait donc d'intégrer dans la stratégie nationale une dimension d'inclusion digitale, en soutenant la montée en compétences des utilisateurs, en favorisant l'accès à des outils abordables, et en développant des interfaces plus conviviales, notamment en langue arabe.
À l'international, plusieurs pays ont relevé ces mêmes défis avec des approches inspirantes :
Le Mexique, pionnier en matière de facturation électronique dès 2011, a dû faire face à une forte disparité d'accès parmi les petites entreprises. Les autorités ont rapidement réagi en mettant à disposition des solutions publiques gratuites et faciles d'utilisation.
L'Italie, qui a adopté le système en 2019, a connu un démarrage complexe sur le plan technique, mais a su ajuster ses exigences réglementaires au fil du temps en écoutant les retours du terrain.
Le Portugal a brillamment combiné obligation et incitation, en proposant une plateforme publique gratuite (e-Fatura) tout en récompensant les citoyens qui exigent une facture électronique via des déductions fiscales, créant ainsi un cercle vertueux entre administration, entreprises et consommateurs.
Dans cette dynamique mondiale, l'Afrique n'est pas en reste. L'expérience de la facturation électronique sur le continent affiche des résultats contrastés selon les pays, mais elle marque un tournant positif dans la modernisation des systèmes fiscaux.
Des pays comme le Rwanda, le Kenya ou encore le Maroc se distinguent par une mise en œuvre structurée et des résultats concrets, notamment en matière d'augmentation des recettes fiscales et de lutte contre la fraude.
Cependant, dans plusieurs États d'Afrique subsaharienne, l'adoption reste partielle ou embryonnaire, freinée par des défis d'infrastructure numérique, de coûts d'équipement et de sensibilisation des acteurs économiques.
Malgré ces disparités, la dynamique continentale est clairement engagée vers une généralisation progressive de la facturation électronique, portée par une volonté politique affirmée, des réformes fiscales et une digitalisation croissante des administrations.
Ces expériences, en Afrique comme ailleurs, démontrent que la réussite d'un projet de facturation électronique repose autant sur un encadrement juridique clair que sur une mise en œuvre souple et inclusive, capable de mobiliser efficacement les outils techniques et humains adaptés à chaque contexte.
Conclusion
La généralisation de la facturation électronique représente bien plus qu'un outil de conformité : elle marque un tournant stratégique dans la relation entre l'État tunisien et les opérateurs économiques.
Cependant, pour que cette réforme produise pleinement ses effets (réduction de la fraude, intégration de l'économie informelle, fluidification des échanges) il est essentiel d'adopter une démarche inclusive, graduelle et humanisée. La réussite du projet repose sur un triptyque fondamental : confiance, compétence et accessibilité.
En s'inspirant des meilleures pratiques internationales, la Tunisie peut faire de cette transition un levier de développement, non pas seulement pour l'administration fiscale, mais pour l'ensemble de l'écosystème économique.
La facture électronique ne doit pas être perçue comme une obligation technocratique, mais comme un vecteur d'équité, d'efficience et de transparence. Si l'État garantit un accompagnement efficace et une écoute active des acteurs de terrain, cette réforme peut devenir un modèle régional d'innovation publique, au service d'une fiscalité moderne, citoyenne et inclusive.
Publié le 30/09/25 09:31