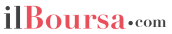Une analyse critique du décalage entre performance bancaire et développement économique.
Par Anis WAHABI
Expert-Comptable
Qu'attendons-nous des banques ? Cette question, apparemment simple, révèle toute sa complexité lorsqu'on l'examine à travers le prisme de l'économie tunisienne contemporaine.
Dans l'imaginaire collectif, les banques sont perçues comme les artères du système économique, irriguant l'économie de liquidités indispensables à la croissance, facilitant l'épargne des ménages, et démocratisant l'accès au crédit pour les entrepreneurs et les particuliers. Elles constituent, en théorie, le maillon essentiel entre l'épargne et l'investissement, transformant les dépôts oisifs en capital productif.
Cette vision idéalisée du rôle bancaire se heurte pourtant à une réalité tunisienne troublante : alors que l'économie nationale traverse une décennie de crise marquée par une croissance anémique (1,4% en 2024), un chômage structurel touchant 16% de la population active, et des déséquilibres macroéconomiques persistants, le secteur bancaire affiche des performances financières remarquablement solides. Cette dichotomie entre prospérité bancaire et stagnation économique constitue le cœur du paradoxe tunisien.
Au-delà des considérations économiques, cette situation interroge notre conception même du rôle social et développemental des banques. Dans un pays où 64% des citoyens demeurent exclus du système bancaire formel, où les PME peinent à accéder au crédit, et où l'innovation entrepreneuriale se heurte aux rigidités du financement traditionnel, les attentes vis-à-vis du secteur bancaire transcendent la simple recherche de rentabilité. Elles touchent aux questions fondamentales de justice sociale, d'équité territoriale, et de développement inclusif.
Cette étude propose une analyse critique du secteur bancaire tunisien qui va au-delà du diagnostic technique pour interroger les fondements mêmes du contrat social implicite entre les banques et la société tunisienne. Nous examinons les mécanismes qui permettent aux 23 établissements bancaires tunisiens de maintenir une rentabilité élevée dans un contexte économique dégradé, tout en questionnant leur contribution effective aux objectifs de développement économique et d'inclusion financière que la société est en droit d'attendre d'eux.
Le paradoxe de la rentabilité bancaire face à la crise économique
Performance financière exceptionnelle du secteur bancaire
L'année 2024 a marqué une nouvelle démonstration de la résilience financière du secteur bancaire tunisien, contrastant violemment avec la morosité économique générale. La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) confirme sa position dominante avec un résultat net de 357,8 millions de dinars, enregistrant une progression de 8 % par rapport à l'année précédente. Cette performance consolide le statut de la BIAT comme locomotive du secteur bancaire tunisien.
Derrière la BIAT, Attijari bank et Amen Bank se distinguent également par leur solidité. Attijari Bank affiche un résultat net de 232,388 millions de dinars (+9,6 %), tandis qu'Amen Bank réalise une croissance impressionnante de 18 % pour atteindre 230 millions de dinars.
Les banques publiques ne sont pas en reste dans cette course aux bénéfices. La Société Tunisienne de Banque (STB) a affiché un résultat net de 82,5 millions de dinars, démontrant que même les établissements publics, théoriquement orientés vers une mission de service public, parviennent à dégager des marges substantielles.
Cette prospérité bancaire s'inscrit dans une tendance de long terme. La rentabilité des banques tunisiennes a rebondi à des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie au premier semestre 2022, le rendement annualisé des fonds propres moyens du secteur passant à 16%, contre 10% en 2021. Ces chiffres traduisent une capacité d'adaptation remarquable aux conditions économiques adverses.
Stagnation économique et défis macroéconomiques
En contrepoint de cette prospérité bancaire, l'économie tunisienne affiche des signes de faiblesse structurelle préoccupants. Depuis la forte contraction provoquée par la pandémie de COVID-19 en 2020 (-8,8 %), la croissance de la Tunisie est restée modérée. Après un rebond en 2021 (4,3 %) et en 2022 (2,7 %), l'activité économique est restée stagnante en 2023 (0 %) avant de progresser légèrement en 2024 (1,4 %).
Cette performance économique médiocre s'accompagne de déséquilibres structurels persistants. Le taux de croissance du PIB a chuté à 0,4 % en 2023, en raison de la sécheresse qui a touché le secteur agricole et d'une baisse de la demande intérieure. L'inflation a continué à augmenter, atteignant 9,3 % en 2023, érodant le pouvoir d'achat des ménages tunisiens.
Les perspectives économiques demeurent moroses. L'économie tunisienne a enregistré une croissance de 1,4 % en 2024, marquant une légère amélioration par rapport à 2023, mais cette reprise reste insuffisante pour résorber les déséquilibres accumulés.
La déconnexion entre performance bancaire et financement de l'économie
Le paradoxe s'accentue lorsqu'on examine la contribution effective des banques au financement de l'économie productive. Alors que les banques affichent des bénéfices solides, elles n'ont toujours pas mis en place la ligne de financement destinée aux petites et moyennes entreprises (PME), comme prévu par l'article 412 III de la nouvelle loi d'août 2024, dite " loi sur les chèques ".
Cette réglementation prévoit la mobilisation de 8% des bénéfices nets des banques pour créer des lignes de crédit à court terme (jusqu'à deux ans), destinées à soutenir les PME, à des conditions avantageuses. L'absence de mise en œuvre de cette disposition révèle une résistance du secteur bancaire à orienter ses profits vers le financement de l'économie réelle.
Plus significatif encore, la STB a connu une baisse de son produit net bancaire ainsi que de ses financements à l'économie, ses crédits ayant reculé de 7,04 %, pour s'établir à 9 774,3 millions de dinars. Cette situation illustre parfaitement le paradoxe : une banque qui dégage des bénéfices substantiels tout en réduisant sa contribution au financement de l'économie.
L'anatomie d'un oligopole : concentration et structures de marché
La domination des "Big Three" publiques
Le secteur bancaire tunisien présente une structure oligopolistique marquée par la domination de quelques acteurs majeurs. Les " Big three " tunisiennes sont des géants aux pieds d'argile. En effet en 2013, la BNA a presque atteint 8 milliards de dinars de total de bilan, la STB est à plus de 7 milliards et la BH à près de 6 milliards. Sur l'ensemble du système (banques cotées) qui représente environ 60 milliards d'actifs, ces trois banques représentent à elles-seules plus de 35% de l'activité.
Cette concentration oligopolistique ne se traduit pas par une amélioration de la qualité de service ou une baisse des coûts, mais plutôt par une mutualisation des risques qui pèse sur l'ensemble du système. Il s'agit là d'un cas de figure de " mauvaise " concentration car cette situation conduit à un coût du risque très élevé. Les trois banques se partagent presque la moitié de ce coût.
Un marché surdimensionné et sous-efficient
L'analyse comparative révèle une anomalie structurelle dans le secteur bancaire tunisien. Avec 23 banques publiques et privées, la Tunisie devrait disposer d'une offre bancaire stimulée par la concurrence, à la pointe pour gérer l'argent des Tunisiens et surtout pour financer l'économie. Or, c'est loin d'être le cas.
Cette densité bancaire apparente cache en réalité une concentration effective du pouvoir économique entre quelques familles influentes. Quelques familles détiennent des participations croisées dans les principales banques et n'ont donc aucun intérêt à exacerber la concurrence.
Les barrières à l'entrée et la reproduction des élites
Le rapport de l'International Crisis Group met en lumière les mécanismes d'exclusion qui caractérisent le secteur bancaire tunisien. L'accès au crédit, lequel détermine quel opérateur économique peut rejoindre le monde des affaires, est également restrictif. Les banques sont majoritairement publiques ou semi-publiques et les banques privées forment un oligopole.
Cette structure oligopolistique crée des conditions d'accès discriminatoires. L'ONG relève ainsi la difficulté d'obtenir un crédit pour une entreprise qui a peu d'argent ou de relations dans le milieu bancaire. Le système favorise ainsi la reproduction des élites économiques au détriment de l'émergence de nouveaux acteurs.
Déficit manifeste d'inclusion bancaire et de digitalisation des services
La Tunisie fait face à un défi considérable en matière d'inclusion financière, avec 64% de sa population adulte privée d'accès à un compte bancaire personnel, selon les données de l'OCDE. Cette exclusion massive révèle les dysfonctionnements profonds d'un système bancaire qui peine à remplir sa mission d'intermédiation au service de l'ensemble de la société.
Les disparités sont particulièrement marquées : les femmes subissent une exclusion bancaire deux fois supérieure à celle des hommes à statut social égal, tandis que les populations rurales et les catégories socioéconomiques vulnérables demeurent largement marginalisées par un système bancaire concentré dans les centres urbains.
Paradoxalement, même parmi les 36% de Tunisiens disposant d'un compte bancaire, l'utilisation des instruments de paiement numérique demeure dramatiquement faible. Selon les données de la Banque centrale, seulement 22% des transactions par carte bancaire correspondent à des paiements effectifs, tandis que 78% se limitent à des retraits d'espèces aux distributeurs automatiques.
Cette situation révèle une sous-utilisation chronique des 6,9 millions de cartes bancaires en circulation, transformées en simples outils d'accès aux liquidités plutôt qu'en véritables instruments de paiement moderne. L'infrastructure elle-même souffre de dysfonctionnements : sur les 34 600 terminaux de paiement électronique déployés, une part importante demeure inactive, concentrée essentiellement dans la Grand Tunis et les grandes villes.
Cette résistance au paiement numérique, alimentée par une culture du cash profondément ancrée et l'absence d'incitations fiscales, maintient la Tunisie dans un retard technologique préoccupant par rapport aux standards régionaux de digitalisation financière.
Pratiques anticoncurrentielles et économie de rente
Condamnations judiciaires pour entente illicite
L'existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur bancaire tunisien n'est plus une simple suspicion mais une réalité documentée par les instances judiciaires. Le Conseil de la concurrence a rendu mercredi 29 mai 2024 une décision préliminaire condamnant un certain nombre d'établissements bancaires tunisiens, pour pratiques anticoncurrentielles au sens de la loi n° 36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.
L'accusation portait sur une entente illicite sur l'imposition d'intérêt sur les reportés pendant la pandémie du Covid. Cette condamnation révèle l'existence de mécanismes de coordination entre banques pour maintenir des niveaux de rentabilité élevés, même dans des circonstances exceptionnelles comme la pandémie.
La sanction financière imposée témoigne de la gravité des pratiques identifiées : Les banques, dont les identités n'ont pas été révélées, ont été condamnées à 142 millions DT d'amende. Cette amende substantielle confirme l'ampleur des préjudices causés à la concurrence et aux consommateurs.
Les mécanismes de l'économie de rente
Le fonctionnement du secteur bancaire tunisien s'inscrit dans ce que les économistes qualifient d'économie de rente. La notion d'économie de rente fait son entrée dans le débat public tunisien. Elle désigne la collusion entre le pouvoir politique et un cartel de familles qui contrôle l'activité économique au détriment du progrès social qui a survécu à la révolution.
Au cœur de ce dispositif, comme l'expliquait Anis Marrakchi, lors d'une conférence donnée en janvier 2019, se trouve le secteur bancaire. Cette position centrale permet aux banques de jouer un rôle de gatekeeper dans l'allocation des ressources financières, favorisant certains acteurs au détriment d'autres.
La persistance des privilèges post-révolutionnaires
L'analyse historique révèle que la révolution de 2011 n'a pas fondamentalement transformé les structures économiques. Si bien que, estime le politologue Bilel Kchouk, " le changement de régime a ainsi été, surtout économiquement, largement bénéfique aux puissants entrepreneurs ayant prospéré sous le régime de Ben Ali ".
Cette continuité s'explique par la persistance des mécanismes de contrôle. Ce modèle a légué à l'économie tunisienne des caractéristiques durables : la confusion entre le domaine public et le patrimoine personnel, la nécessité de disposer d'une relation privilégiée avec le pouvoir pour entrer et se maintenir dans les affaires.
L'impact sur les citoyens : frais exorbitants et services défaillants
L'explosion des frais bancaires
L'une des manifestations les plus visibles de la rente bancaire réside dans l'évolution des tarifs pratiqués aux consommateurs. Selon l'Observatoire tunisien de l'inclusion financière (OIF), les banques tunisiennes sont gourmandes sur les frais de tenue de compte. Sur les 21 banques citées par l'Observatoire, le tarif annuel moyen des frais de tenue de compte s'élève cette année à 99,950 dinars.
Cette tendance haussière s'est considérablement accélérée au cours de la dernière décennie. L'envolée des frais de tenue de compte a fortement impacté l'évolution de l'Indice des Prix des Services Bancaires (IPSB) qui s'est accru de 65,8% entre 2010 et 2017. Cette progression dépasse largement l'inflation générale et témoigne d'une dérive tarifaire préoccupante.
La diversification des sources de revenus non productifs
Au-delà des frais de tenue de compte, et selon l'Observatoire tunisien de l'inclusion financière (OIF), les banques tunisiennes ont développé une stratégie de multiplication des commissions sur l'ensemble des opérations bancaires. Pour les opérations en espèces, le tarif moyen pour les versements dans une autre agence que celle du client est compris entre 0,430 dinar et 150,7 dinars.
Plusieurs banques ne touchent aucune commission. Les plus chères étant Attijari Bank qui peut toucher 1% du montant versé avec un plafond de 1.000 dinars et la BNA qui peut toucher 50 dinars.
Cette stratégie de tarification différenciée crée une opacité délibérée qui nuit à la transparence du marché. Chaque année, ce sont des millions de dinars de pouvoir d'achat que les Tunisiens abandonnent sans broncher pour des frais bancaires loin d'être toujours justifiés.
L'inertie des consommateurs et l'asymétrie informationnelle
L'exploitation de la rente bancaire est facilitée par le comportement des consommateurs tunisiens. L'OCDE a dernièrement réalisé une étude sur la concurrence dans le secteur de la banque de détail en Tunisie. Plus important, pour un client tunisien qui se plaint toujours des taux et des commissions bancaires, la constatation de l'OCDE que 80 % des consommateurs tunisiens ne comparent pas les frais lors de l'ouverture des comptes.
Cette asymétrie informationnelle permet aux banques de maintenir des tarifs élevés sans risquer une fuite massive de leur clientèle. Pourtant, trop peu de Tunisiens font jouer la concurrence, créant les conditions idéales pour la perpétuation de la rente bancaire.
L'échec de la mission d'intermédiation financière
Le détournement vers le financement public
L'une des critiques les plus fondamentales adressées au secteur bancaire tunisien concerne son détournement de sa mission première d'intermédiation financière au profit du financement de l'État. Selon les constats de la Banque Mondiale, la Tunisie s'oriente de plus en plus vers des sources de financement internes, la dette intérieure étant passée de 29,7 % de la dette publique totale en 2019 à 51,7 % en août 2024.
Cette réorientation des flux financiers crée un effet d'éviction dommageable pour l'économie privée. Cette tendance oriente une part croissante des financements des banques vers les besoins du gouvernement et les éloigne du reste de l'économie. Les banques trouvent dans le financement public une source de revenus stable et peu risquée, mais au détriment de leur rôle de soutien à l'activité économique.
L'exclusion financière massive
Le système bancaire tunisien échoue également dans sa mission d'inclusion financière. 64 % des Tunisiens n'ont pas de compte courant bancaire personnel, révélant l'ampleur de l'exclusion financière dans le pays. Cette situation contraste avec les objectifs théoriques d'un système bancaire moderne.
Cette exclusion n'est pas uniquement le résultat de contraintes économiques, mais également de pratiques discriminatoires. Pour l'ICG, les banques publiques et un petit nombre de banques privées contrôlent l'accès au crédit et les entreprises tunisiennes n'ont pas d'autre choix que de payer pour obtenir un prêt.
La rigidité bureaucratique
Le fonctionnement bureaucratique des banques tunisiennes constitue un frein supplémentaire à l'efficacité du système. Les établissements bancaires fonctionnent de manière très bureaucratique, rigide et centralisée, selon l'analyse de l'ICG.
Cette rigidité se traduit par des conditions d'accès au crédit particulièrement dissuasives. Les services sont médiocres malgré des frais astronomiques, et les conditions d'accès au crédit pour les entreprises sont dissuasives pour la majorité des entrepreneurs.
Leçons du benchmark international : programmes de réforme bancaire réussis
L'expérience internationale offre des enseignements précieux sur les voies possibles de transformation du secteur bancaire. Plusieurs pays émergents ont réussi à réformer leurs systèmes bancaires pour les mettre au service du développement économique et de l'inclusion financière, offrant des modèles instructifs pour la Tunisie.
Le modèle brésilien : de la crise à l'inclusion massive
Le Brésil des années 1990 constitue un cas d'école particulièrement éclairant. Confronté à une hyperinflation chronique et à un secteur bancaire fragmenté et inefficient, le pays a entrepris une révolution bancaire sans précédent. Le Plan Real de 1994, au-delà de sa dimension monétaire, s'est accompagné d'une refonte complète du système bancaire brésilien.
La stratégie brésilienne a combiné plusieurs éléments innovants : la consolidation du secteur (réduction du nombre d'établissements de 245 à 164 entre 1994 et 2002), la modernisation technologique accélérée, et surtout le développement de l'inclusion financière via les programmes de transferts conditionnels. Le programme Bolsa Família, qui touche 11 millions de familles soit plus de 46 millions de personnes, a révolutionné l'accès aux services financiers pour les populations les plus démunies.
L'innovation des "correspondants bancaires" a permis d'étendre les services financiers dans les zones reculées via des partenariats avec les commerces locaux. Cette approche a porté le taux de bancarisation de 43% en 2000 à plus de 70% en 2020. Plus récemment, le Brésil a stimulé l'inclusion financière avec des comptes bancaires uniquement numériques, permettant de retirer de l'argent de plus de 19 000 distributeurs automatiques à travers le pays.
L'expérience mexicaine : digitalisation des paiements publics
Le Mexique a choisi une approche différente mais complémentaire en informatisant massivement les paiements publics (salaires, allocations sociales, etc.). En juin 2016, le pays a lancé sa stratégie nationale pour l'inclusion financière en vue d'accélérer l'accès aux services financiers pour plus de la moitié de la population écartée du système financier formel et réglementé.
Cette stratégie s'est appuyée sur le développement d'infrastructures de paiement numérique robustes et la promotion de comptes "low-cost" pour les paiements mobiles et électroniques. Le Mexique a également adapté ses cadres juridiques et réglementaires pour garantir des conditions équitables et recourir à des réglementations différenciées pour promouvoir l'inclusion financière.
Le modèle marocain : réformes progressives et expansion régionale
Plus proche géographiquement et culturellement, le Maroc offre des enseignements particulièrement pertinents. Cette série de financements de la Banque mondiale a permis au Maroc de repousser considérablement les barrières de l'inclusion financière et numérique. Aujourd'hui, selon la Banque Mondiale, 44% des Marocains ont accès à un compte bancaire contre 29% en 2017, et 30% d'entre eux utilisent des paiements numériques contre 17% en 2017.
La stratégie marocaine s'est distinguée par plusieurs innovations : le développement de la micro-assurance, la création d'un registre des nantissements et des garanties pour faciliter l'accès au crédit des PME, et surtout la numérisation des programmes de protection sociale grâce aux transferts monétaires numériques. L'infrastructure des paiements numériques s'est développée avec 31% des zones rurales couvertes par des réseaux de paiement mobile.
Les réformes structurelles en Turquie : de la crise à la stabilité
La Turquie des années 2000 illustre comment un pays peut transformer son secteur bancaire à la suite d' une crise majeure. Après la crise de 2001, la Turquie a mis en place un programme de réformes structurelles ambitieux comprenant : le renforcement de la réglementation prudentielle, la consolidation du secteur bancaire, et surtout la réduction drastique de l'exposition des banques au secteur public.
Les banques turques ont réussi à réduire leur exposition au secteur public de 40% à moins de 15% en l'espace d'une décennie, s'accompagnant d'un développement massif du crédit aux PME et d'une amélioration significative de l'intermédiation financière. Cette réorientation s'est traduite par une croissance économique soutenue et une modernisation du secteur financier.
Leçons transversales des expériences de réforme
L'analyse comparative de ces expériences révèle plusieurs facteurs de succès communs :
Volonté politique forte : Toutes les réformes réussies ont bénéficié d'un portage politique au plus haut niveau et d'une vision claire des objectifs à atteindre.
Approche systémique : Les réformes bancaires efficaces s'inscrivent dans des stratégies de développement plus larges, intégrant les dimensions macroéconomiques, réglementaires et technologiques.
Innovation technologique : L'adoption précoce des technologies numériques constitue un accélérateur décisif, permettant de contourner les contraintes d'infrastructure traditionnelles.
Partenariats public-privé : La collaboration entre autorités publiques et acteurs privés (banques, opérateurs télécom, fintechs) s'avère cruciale pour démultiplier l'impact des réformes.
Mesure et adaptation : Les programmes les plus réussis intègrent des mécanismes de suivi rigoureux et une capacité d'adaptation rapide aux évolutions du contexte.
Ces enseignements internationaux dessinent les contours d'une feuille de route possible pour la transformation du secteur bancaire tunisien, adaptée aux spécificités locales mais inspirée des meilleures pratiques mondiales.
Implications théoriques et recommandations
Redéfinition du rôle attendu des banques
L'analyse du paradoxe bancaire tunisien appelle à une redéfinition fondamentale du rôle attendu des banques dans l'économie. Contrairement au modèle théorique d'intermédiation financière qui postule que les banques allouent efficacement l'épargne vers les investissements les plus productifs, la réalité tunisienne révèle un système orienté vers la maximisation de la rente au détriment de l'efficacité économique.
Cette situation n'est pas viable à long terme car elle crée un cercle vicieux : la faible contribution des banques au financement de l'économie productive entretient la stagnation économique, qui justifie à son tour le repli des banques vers des activités rentières moins risquées.
Nécessité d'une transformation structurelle
La sortie de ce modèle nécessite une transformation structurelle profonde qui dépasse les simples ajustements réglementaires. Il s'agit de repenser entièrement les incitations qui guident le comportement des acteurs bancaires.
Cette transformation devrait s'articuler autour de plusieurs axes :
Renforcement de la concurrence effective : La simple multiplication du nombre d'établissements ne suffit pas si les structures oligopolistiques persistent. Il faut briser les participations croisées et garantir une concurrence réelle.
Transparence tarifaire : L'instauration d'une obligation de transparence complète sur l'ensemble des tarifs bancaires permettrait aux consommateurs de faire jouer la concurrence plus efficacement.
Réorientation des incitations : Les autorités de régulation doivent mettre en place des mécanismes qui pénalisent les comportements rentiers et récompensent la contribution effective au financement de l'économie productive.
Vers un nouveau contrat social bancaire
La situation actuelle révèle l'existence d'un contrat social implicite dysfonctionnel entre les banques et la société tunisienne. Les banques bénéficient de privilèges réglementaires et d'une protection contre la concurrence, mais ne remplissent pas en retour leur obligation de service à l'économie.
Un nouveau contrat social devrait explicitement conditionner ces privilèges à la performance en matière de financement de l'économie réelle et d'inclusion financière. Cette approche nécessite un engagement politique fort et une mobilisation de la société civile pour surmonter les résistances des intérêts établis.
Conclusion
Le paradoxe bancaire tunisien révèle les limites d'un modèle économique qui privilégie l'extraction de rente sur la création de valeur. Alors que les banques accumulent des profits substantiels, l'économie tunisienne stagne et les citoyens subissent les conséquences d'un système financier défaillant dans sa mission fondamentale.
Cette situation n'est pas une fatalité mais le résultat de choix politiques et économiques qui peuvent être remis en question. La condamnation récente de banques pour pratiques anticoncurrentielles par le Conseil de la concurrence montre que les instruments juridiques existent pour lutter contre ces dérives.
L'enjeu dépasse les considérations purement économiques pour toucher à la question de la justice sociale et de l'équité. Un système bancaire qui enrichit ses actionnaires tout en appauvrissant l'économie nationale pose des questions fondamentales sur la répartition des richesses et le rôle de l'État dans la régulation des marchés.
La transformation du secteur bancaire tunisien constitue donc un préalable indispensable à toute stratégie de développement économique durable. Elle nécessite une volonté politique forte, une mobilisation de la société civile, et une refondation des règles du jeu économique qui ont trop longtemps favorisé les rentes au détriment de l'innovation et de la création de valeur.
L'alternative est claire : soit les banques tunisiennes évoluent vers un modèle plus inclusif et plus contributif au développement économique, soit elles risquent de devenir un frein structurel à la modernisation du pays.
Publié le 18/09/25 11:39